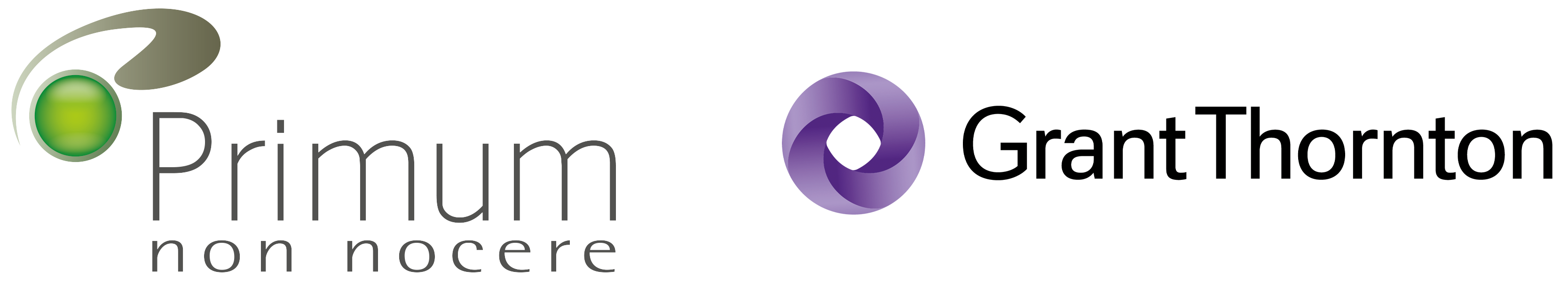Pour une politique du médicament à la hauteur des enjeux du XXIe siècle
10/04/2025
Laudato Si’, 10 ans après
24/04/2025Le bruit, ce mal sourd qui épuise et désensibilise

Encore sous-estimées, les nuisances sonores sont pourtant l’une des causes principales d’arrêts de travail en France. Dans les bureaux, les chantiers, les restaurants, les open-spaces ou les hôpitaux, le bruit s’impose comme un facteur de risque professionnel majeur. À tel point que le ministère du Travail lui consacre un dossier entier, et que l’ADEME a chiffré son coût social à 147 milliards d’euros par an, incluant impacts sanitaires, stress, perte de concentration, troubles du sommeil et accidents. Le bruit ne fait pas de bruit… mais ses conséquences, elles, sont assourdissantes.
Dans les établissements de santé, ce bruit ambiant devient même un danger silencieux aux effets tragiques. Dans les couloirs des hôpitaux, un phénomène préoccupant prend de l’ampleur : la fatigue des alarmes. Le personnel soignant, confronté à près d’un millier de signaux sonores par jour, développe peu à peu une insensibilité involontaire à ces sons, pourtant censés les alerter d’un danger imminent. Moniteurs cardiaques, pompes à perfusion, respirateurs… chaque appareil médical émet des alertes sonores en cascade. Mais seulement 15 % de ces alarmes nécessitent réellement une intervention. Ce flot incessant provoque un effet paradoxal : plus il y a d’alertes, moins elles sont écoutées.
Ce phénomène, appelé « syndrome de désensibilisation aux alarmes médicales », a déjà fait des victimes. Selon les données de la FDA américaine, 566 décès entre 2005 et 2010 seraient liés à cette saturation acoustique. Le personnel soignant, exposé à une cacophonie constante, finit par ne plus distinguer le signal critique du bruit ambiant. Dans cet environnement sonore surchargé, le silence devient rare, et l’écoute sélective devient une nécessité de survie psychologique, au détriment de la vigilance.
Face à cette situation, des chercheurs comme Joseph Schlesinger, anesthésiste au centre médical de l’université Vanderbilt, et Michael Schutz, musicologue à l’université McMaster, ont proposé des solutions inattendues : repenser les alarmes à travers la musique. Leur idée ? Abandonner les sons stridents et plats pour des signaux aux timbres complexes, inspirés d’instruments comme le xylophone, plus doux à l’oreille mais tout aussi distinctifs. Dans une étude menée auprès de 42 participants, ces alarmes musicales ont été jugées 88 % moins irritantes, sans compromettre leur efficacité de reconnaissance. Mieux : elles favorisent une écoute active, en réduisant le stress et l’agacement que suscitent les alarmes classiques.
Cette approche ouvre la voie à une véritable écologie sonore hospitalière. L’homogénéisation mondiale des dispositifs médicaux a conduit à une standardisation de leurs sons : mêmes fréquences, mêmes timbres, mêmes tonalités. Si cela facilite la formation du personnel à l’échelle internationale, cela crée aussi une monotonie acoustique qui nuit à l’attention. En s’inspirant des techniques musicales, les concepteurs d’alarmes peuvent créer une palette sonore plus riche et émotionnellement engageante, réduisant l’effet de saturation et renforçant la sécurité des soins. La musique, dit-on, adoucit les mœurs ; dans les hôpitaux, elle pourrait surtout sauver des vies.
Mais les hôpitaux ne sont pas les seuls concernés. Dans tous les environnements professionnels, il est temps d’agir pour réduire les nuisances sonores de manière structurelle. Cela passe d’abord par l’intégration systématique du risque bruit dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Mesures de bruit, évaluation des équipements, cartographie sonore des espaces de travail, suivi annuel : la prévention doit devenir rigoureuse et régulière.
La formation initiale aussi doit évoluer : les écoles d’architecture, de médecine, d’ingénierie, de restauration et de design doivent intégrer une culture de l’acoustique dès les premiers cycles, pour faire du calme une exigence de qualité de vie et de sécurité. Dans les appels d’offres, les politiques d’achats responsables devraient inclure un critère sonore au même titre que l’énergie, le CO₂ ou la consommation d’eau : un score décibel, pour choisir les équipements et services les moins bruyants.
Les solutions existent : matériaux isolants, plafonds acoustiques, mobilier absorbant, pièges à sons, zones silencieuses, capteurs de bruit dans les lieux publics pour sensibiliser en temps réel… Tout cela n’est plus du domaine du luxe, mais de la santé publique. Vive l’éco conception des bâtiments de santé…
Enfin, l’éducation sonore doit s’imposer dans notre quotidien. Apprendre à parler moins fort, fermer une porte doucement, choisir un appareil silencieux, réduire le volume chez soi… Cela commence par une prise de conscience, et se poursuit par des gestes simples. Il s’agit de réapprendre à entendre, à respecter l’espace sonore partagé, à rendre possible la concentration, l’attention… et l’écoute.
Car ce que nous cherchons, au fond, c’est un monde moins bruyant, mais plus vibrant. Un monde où le silence n’est pas une absence, mais une présence apaisante. Où la prévention du bruit devient un levier d’amélioration du bien-être collectif. Et où chaque décision – dans le bâtiment, la santé, les services ou les politiques publiques – porte en elle la promesse d’un environnement plus calme, plus sain… et plus humain.
Olivier TOMA
Fondateur de Primum Non Nocere®