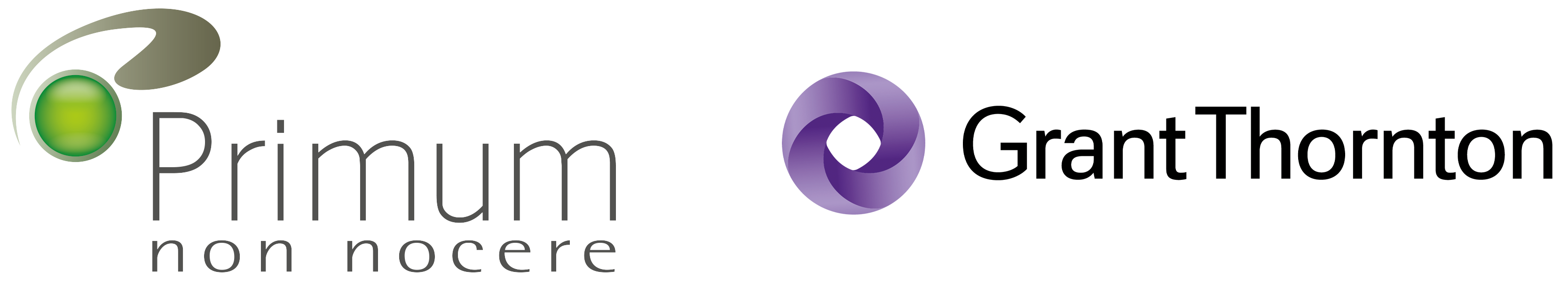Thermalisme & Santé Environnementale : et si la France devenait le leader mondial d’un thermalisme responsable ?
06/03/2025
Nutri-Score et restauration collective – Une opportunité à saisir
19/03/2025L’intelligence augmentée et collective (IAC) : réconcilier l’humain et la machine pour réinventer le futur

L’intelligence artificielle bouleverse notre monde, repoussant chaque jour les limites de l’analyse et de la prédiction. Mais elle reste une intelligence conceptuelle, enfermée dans la logique de la donnée, incapable d’agir, de ressentir ou de s’adapter en dehors des schémas qu’elle connaît. En parallèle, l’intelligence collective, celle qui naît de la collaboration entre les humains, offre une richesse inestimable. Elle est agile, intuitive, ancrée dans la réalité. Pourtant, elle se heurte souvent à ses propres limites : elle peut être lente, brouillonne, tributaire des biais et des émotions.
Et si ces deux formes d’intelligence, au lieu de s’opposer, s’unissaient pour créer un modèle inédit ? Une intelligence qui ne serait ni purement artificielle, ni simplement humaine, mais un écosystème où la puissance de calcul de l’IA rencontre la créativité, l’intuition et l’expérience du collectif. Une intelligence augmentée et collective, où la machine et l’homme ne se contenteraient plus de coexister, mais apprendraient à se compléter.
Ce n’est pas une utopie. C’est un mouvement en marche, déjà visible dans le domaine de la santé et de la recherche. Des initiatives émergent, des modèles se transforment, des institutions expérimentent cette fusion entre la précision algorithmique et l’intelligence vivante des équipes humaines.
Dans le secteur hospitalier, l’intelligence collective se manifeste déjà sous des formes remarquables. Vivalto Santé, premier groupe hospitalier français à adopter le statut d’Entreprise à Mission, a fait le choix d’une gouvernance partagée, impliquant médecins, patients et soignants dans l’élaboration des décisions stratégiques. Loin d’un modèle vertical où les choix sont imposés par le sommet, l’hôpital devient un lieu où chacun contribue, où les savoirs se croisent et s’enrichissent.
Au CHU de Toulouse, l’intelligence collective s’exprime à travers l’éco-conception des soins. Face à l’urgence environnementale, les soignants se sont regroupés pour repenser leurs pratiques, abandonnant peu à peu le tout-jetable au profit de solutions plus durables. C’est une démarche pragmatique et collaborative, qui ne repose pas sur un programme imposé d’en haut, mais sur une intelligence du terrain, née de l’expérience et du dialogue.
Dans un autre registre, le GHT Atlantique 17 a démontré que la coopération entre les hôpitaux pouvait transformer en profondeur les processus d’achats hospitaliers. Grâce à une mutualisation réfléchie et une collaboration entre services, ils ont réduit leur empreinte carbone tout en optimisant les coûts et la qualité des équipements.
Nous-mêmes avons expérimenté la puissance de l’intelligence collective au sein de notre propre équipe. Formés à la gouvernance partagée, nous avons appris à naviguer dans cette dynamique où la prise de décision n’est plus une affaire d’individus, mais un processus fluide et inclusif. Le début fut complexe, car loin d’être intuitif, mais la suite s’est révélée fascinante. C’est ainsi que nous avons expérimenté l’élection sans candidat pour désigner notre référent RSE, un exercice où la légitimité émerge naturellement du groupe.
Grâce à cette approche, nous avons conçu, en seulement deux ans, des outils innovants qui sont aujourd’hui testés dans plusieurs hôpitaux. L’empreinte hydrique globale, capable d’évaluer la consommation en eau d’un service ou d’un produit. Un diagnostic biodiversité, dont l’importance a été reconnue et soutenue à hauteur de 50 % par la BPI. Un outil de mesure du bien-être et de la santé, le B2ST, déjà utilisé par de nombreuses organisations pour structurer des observatoires et des plans d’action par service. Un DOMI’SCORE®, pensé pour intégrer la santé environnementale au domicile dans le cadre des hospitalisations à domicile.
Mais l’expérience ne s’arrête pas là. Un livre est en cours d’écriture, une première du genre. Six mains pour un seul texte, où chaque phrase, chaque idée, est pensée et validée ensemble, dans une harmonie parfaite. Un ouvrage qui verra le jour en décembre 2025 et qui portera sur le principe du KYOSEÏ, cette philosophie japonaise du « vivre et agir ensemble pour le bien commun ».
Et ce n’est pas tout. L’intelligence collective nous pousse aujourd’hui à imaginer encore plus loin, avec le développement d’un logiciel d’éco-conception des soins, et un éco-score des médicaments, afin d’évaluer leur impact sur l’environnement et la santé humaine.
Tout cela a été rendu possible par une seule chose : la force du collectif.
Mais c’est peut-être dans le domaine de la recherche que l’intelligence collective atteint son paroxysme. À l’INSERM, des chercheurs travaillent sur les perturbateurs endocriniens en intégrant les citoyens à leur démarche. Des plateformes collaboratives permettent aux particuliers d’envoyer leurs propres échantillons biologiques, enrichissant ainsi les données scientifiques tout en sensibilisant la population aux enjeux de la toxicologie environnementale. Cette approche brise les frontières entre science et société, offrant un modèle où la recherche n’est plus réservée aux laboratoires, mais devient une aventure collective.
En Europe, le projet EXHAUSTION illustre une autre facette de cette intelligence partagée. Des chercheurs issus de dix pays unissent leurs expertises pour comprendre comment la pollution de l’air et le changement climatique affectent la santé cardiorespiratoire. Au-delà des analyses scientifiques, leur mission est aussi d’orienter les politiques publiques, d’accompagner les collectivités dans l’adaptation à ces nouvelles réalités.
Au Japon, l’Université de Kyoto explore une autre dimension de cette intelligence hybride en développant des recherches sur la médecine régénérative inspirée de la nature. Les scientifiques s’inspirent des capacités des salamandres et autres espèces capables de régénérer leurs tissus pour imaginer des thérapies révolutionnaires. Ici, la collaboration entre l’IA et l’intelligence collective est essentielle : les algorithmes modélisent des milliers de scénarios biologiques, mais ce sont les chercheurs qui testent, ajustent et explorent des chemins inédits.
Ces expériences montrent que la fusion entre l’IA et l’intelligence collective n’est pas une simple idée théorique, mais une dynamique déjà en marche. L’IA seule est un outil puissant, mais froid, sans vision ni conscience. L’intelligence collective est vibrante, inventive, mais parfois désordonnée et limitée par la subjectivité humaine.
L’intelligence augmentée et collective réconcilie ces deux mondes. L’IA structure, modélise, identifie des tendances invisibles à l’œil humain. L’intelligence collective, elle, donne du sens, adapte, transforme ces prédictions en actions réelles. Dans la médecine de demain, l’IA pourra prédire un diagnostic en quelques millisecondes, mais c’est un collectif humain qui décidera du protocole à suivre, en fonction des spécificités du patient. Dans la lutte contre le changement climatique, l’IA simulera les effets de différentes politiques, mais ce seront les chercheurs, les citoyens et les décideurs qui construiront les réponses adaptées aux réalités locales.
Nous entrons dans une ère où l’intelligence ne sera plus unique, mais multiple. Une intelligence fluide, qui se nourrit des algorithmes sans s’y soumettre, qui mobilise la puissance du calcul sans abandonner l’intuition humaine.
Le défi est immense, mais l’opportunité l’est tout autant. Si nous savons organiser cette symbiose, si nous apprenons à marier la force prédictive de l’IA avec l’agilité du collectif humain, alors nous pourrons non seulement résoudre des problèmes complexes, mais surtout, bâtir un monde plus équilibré, plus durable, et profondément humain.
L’intelligence augmentée et collective n’est pas un simple concept. C’est la voie vers l’avenir.
Olivier TOMA
Fondateur de Primum Non Nocere®