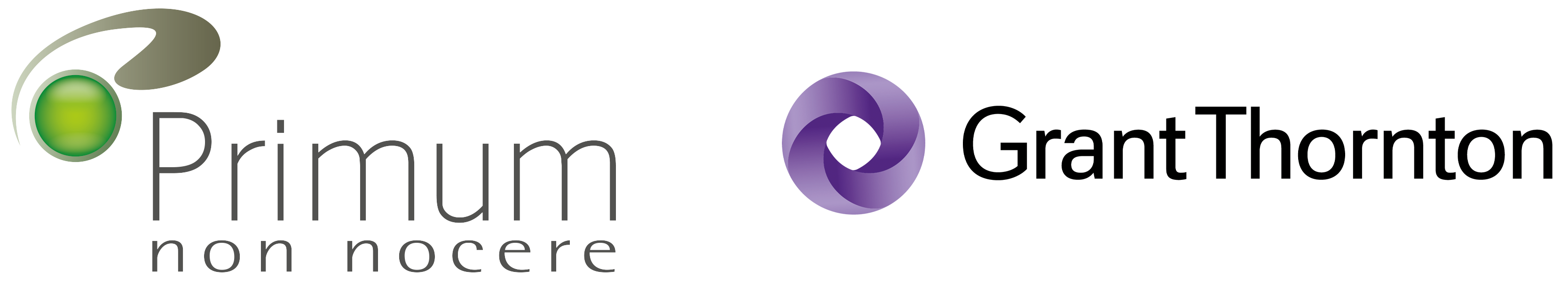Club Tendance RSE
09/05/2025
Soigner l’empreinte globale de la santé : entre décarbonation des soins et éco-conception des parcours
05/06/2025Sûreté et sécurité en santé : un pilier invisible de la RSE

Chaque jour en France, 65 professionnels de santé sont agressés. Ce chiffre vertigineux – et sous-estimé – révèle une réalité troublante : soigner expose. À l’heure où le système de santé cherche à renforcer son attractivité, garantir la sécurité et la sûreté de celles et ceux qui le portent est devenu une condition sine qua non d’un avenir durable. Ce n’est pas seulement un sujet de conditions de travail : c’est un véritable enjeu de responsabilité sociétale (RSE), de résilience du système, et de confiance entre professionnels, patients et institutions.
Sécurité, sûreté : deux notions sœurs, deux approches complémentaires
En langage courant, on les confond souvent. Pourtant, la sécurité désigne la prévention des risques accidentels : incendie, chutes, infections, erreurs médicamenteuses, etc. La sûreté, elle, se concentre sur les risques d’origine volontaire ou malveillante : violences, intrusions, vols, agressions, cyberattaques…
Dans les établissements de santé, ces deux dimensions doivent cohabiter harmonieusement. Mais force est de constater que la culture de la sûreté y est encore émergente. À l’inverse, le secteur aérien – autre domaine sensible, à très haut niveau de responsabilité – a bâti depuis des décennies une culture de sûreté mature, standardisée et auditée en continu. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?
Et si l’on prenait exemple sur l’aviation civile ?
Dans l’aérien, aucun avion ne décolle si les standards de sûreté ne sont pas réunis. Chaque incident est remonté, analysé, partagé. L’erreur humaine est analysée , le retour d’expérience est permanent, et les personnels savent qu’ils bénéficient d’un haut niveau de protection physique, psychologique et juridique.
Transposée à la santé, cette approche permettrait de renforcer :
- la prévention des actes malveillants (agressions, intrusions, vols de matériel médical ou stupéfiants),
- la gestion des situations critiques (crises sanitaires, risques NRBC, cyberattaques),
- et surtout, la confiance des soignants dans leur environnement de travail.
La RSE prend ici tout son sens : elle ne se limite pas aux enjeux climatiques ou sociaux, mais intègre aussi la protection des personnes et la résilience des organisations.
L’ONVS : l’observatoire encore trop méconnu
Depuis 2005, l’Observatoire national des violences en santé (ONVS) recueille les signalements d’actes de violence dans les établissements de santé. Le dernier rapport en date (données 2020-2021) mérite qu’on s’y attarde :
– 22 259 signalements d’agressions en 2020, en hausse malgré la crise COVID.
– Les cibles principales ? Les infirmiers (41 % des cas) et les médecins (23 %).
– 84 % des faits sont commis par des patients ou usagers, souvent dans des contextes de tension, de troubles cognitifs ou de fragilité psychique.
– Les services les plus concernés : urgences, psychiatrie, gériatrie, médecine polyvalente.
Malgré l’ampleur des chiffres, seulement un signalement sur trois donne lieu à une plainte. Les professionnels craignent de ne pas être entendus, ou redoutent des conséquences dans la relation de soins. Il est urgent de transformer cette peur en réflexe citoyen, soutenu par l’institution.
Une réponse politique attendue : tolérance zéro
Le 13 mai 2025, le Sénat s’apprête à adopter définitivement une proposition de loi renforçant la réponse pénale face aux violences envers les soignants. Ce texte – salué par toute la profession – acte des avancées majeures :
- Alourdissement des peines : jusqu’à 20 ans de réclusion en cas de violences graves, 7 ans pour agressions sexuelles, 5 ans pour vol.
- Extension du périmètre : tous les professionnels, y compris à domicile, sont protégés.
- Reconnaissance du délit d’outrage et d’injure commis dans les établissements ou à domicile.
- Facilitation du dépôt de plainte : par les directions, les ordres professionnels, les URPS… et bientôt via un outil de visioplainte.
- Prévention renforcée dans les secteurs sensibles, notamment en psychiatrie.
- Protection fonctionnelle garantie pour tous les agents publics entendus dans le cadre d’une procédure.
Ce tournant législatif – sous le mot d’ordre « zéro impunité » – marque une avancée significative, mais il ne suffira pas. Il faut, à tous les niveaux, structurer une vraie politique de sûreté sanitaire.
Sécuriser les soignants, c’est soigner la santé publique
Mettre en place une stratégie de sûreté dans les hôpitaux et les structures de santé, c’est redonner aux soignants le droit fondamental d’exercer sans peur. C’est garantir aux patients un climat de confiance et de sérénité. C’est assurer la pérennité du système, qui ne pourra attirer, retenir et protéger ses forces vives que s’il leur offre les conditions d’une mission apaisée.
La RSE ne peut ignorer cette dimension. Dans un monde incertain, la protection des femmes et des hommes qui soignent devient l’un des socles d’une santé durable. »
Olivier TOMA
Fondateur de Primum Non Nocere®