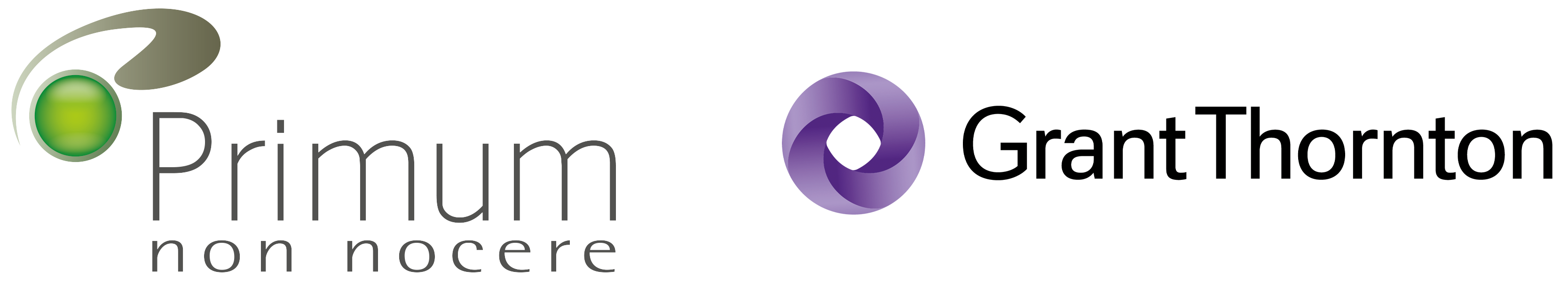Sûreté et sécurité en santé : un pilier invisible de la RSE
15/05/2025
Le paradoxe du plastique en santé : vital pour l’hygiène, toxique pour la planète… et pour nous
19/06/2025Soigner l’empreinte globale de la santé : entre décarbonation des soins et éco-conception des parcours

Depuis quelques années, un chiffre est devenu un étendard : le secteur de la santé serait responsable de 8 % des émissions de gaz à effet de serre de l’économie française. Un chiffre qui a permis de déclencher une salutaire prise de conscience. Pour la première fois, le monde de la santé s’est regardé non seulement comme un rempart contre les maladies, mais aussi comme un acteur aux impacts environnementaux significatifs.
Mais s’arrêter à cette seule mesure carbone, et à cette seule focale, serait une erreur.
Au-delà du carbone, la santé a d’autres empreintes
Car réduire les émissions de CO₂ ne saurait résumer à elle seule la mutation écologique, sociale et humaine que le secteur de la santé doit engager. L’empreinte d’un système de santé ne se limite pas à son bilan carbone. Elle est aussi :
- hydrique, avec des milliers de mètres cubes d’eau osmosée utilisés et rejetés chaque jour, notamment en dialyse ;
- chimique, avec les substances médicamenteuses, désinfectantes ou cytotoxiques retrouvées jusque dans les eaux de consommation ;
- aérienne, avec la qualité de l’air intérieur parfois altérée par les composés organiques volatils émis par les matériaux ou les produits d’entretien ;
- sanitaire indirecte, avec l’exposition chronique des soignants et des patients à certains perturbateurs endocriniens ou substances allergènes ;
- humaine, enfin, avec un mal-être croissant des professionnels de santé, des parcours de soins morcelés, des pertes de sens et un rapport au soin de plus en plus contraint.
Une politique de santé durable ne peut se penser uniquement en grammes de CO₂ économisés. Elle doit intégrer toutes ces dimensions – visibles, invisibles, quantifiables ou non – dans une vision élargie de ce que signifie « prendre soin ».
L’éco-conception des soins ne suffit pas : place à l’éco-conception des parcours de santé
Aujourd’hui, les politiques de décarbonation dans le secteur de la santé se concentrent très logiquement sur les médicaments et dispositifs médicaux. Cette approche, compréhensible car appuyée sur des données mesurables, donne lieu à des estimations selon lesquelles plus de 50 % des émissions de CO₂ du secteur seraient liées à ces produits. Mais cette lecture, bien qu’utile, mérite d’être complétée, car elle omet une part majeure des impacts réels.
Prenons un exemple concret : celui d’un patient atteint d’un cancer. La chimiothérapie qu’il reçoit, bien que cruciale, ne représente qu’une fraction de l’empreinte écologique de son parcours. À cela s’ajoutent :
- des centaines de kilomètres parcourus en voiture pour se rendre à l’hôpital,
- des molécules cytotoxiques éliminées dans les urines, parfois non traitées par les stations d’épuration,
- des accompagnants, souvent en double déplacement,
- et bien souvent, un isolement géographique qui complique encore l’équation.
Autre exemple : la dialyse. Ce traitement chronique génère un volume considérable d’eaux usées, des déchets médicaux, et surtout une répétition de trajets quotidiens, parfois sur de longues distances.
Enfin, pensons à ces consultations hebdomadaires chez un professionnel de santé situé à plus de 100 km du domicile du patient : en un an, le seul transport peut représenter plusieurs centaines de kilos de CO₂.
Ces impacts ne figurent dans aucun bilan carbone sectoriel. Ils ne sont pas inclus dans les fameux 8 %, et ne sont pas attribués au système de santé mais à la sphère des mobilités ou des usages individuels.
Pourtant, ils font pleinement partie du parcours de soin réel. Et ce sont bien les choix organisationnels, les modalités d’accès aux soins, la structuration des territoires médicaux et les logiques de remboursement qui les conditionnent.
Repenser les politiques de santé à l’aune des parcours
La transition écologique de la santé ne pourra se faire sans une refonte en profondeur de notre façon d’aborder les parcours de soins. Cela signifie :
- intégrer les mobilités dans les calculs d’impact,
- privilégier les approches de proximité, la télémédecine raisonnée, les réseaux territoriaux de santé,
- évaluer les conséquences indirectes de chaque stratégie de prise en charge.
Il ne s’agit pas de faire reposer la responsabilité sur les patients, ni de pointer du doigt les industriels. Mais de poser un nouveau cadre de réflexion, dans lequel l’impact global – et non seulement l’empreinte carbone des objets de soin – devient le référentiel central.
Soigner autrement, c’est aussi penser autrement
Nous avons franchi une première étape importante en identifiant l’empreinte carbone de la santé. Il est désormais temps de franchir la seconde : comprendre que soigner, c’est un tout. Ce sont des lieux, des flux, des personnes, des temporalités, des produits, des environnements.
La vraie éco-conception ne peut porter uniquement sur les soins. Elle doit englober les parcours de santé dans leur ensemble, car c’est là que réside l’essentiel des impacts… et donc des leviers d’action.
Jusqu’en 2030, et bien au-delà, c’est sur cette vision holistique que devront se fonder les politiques de santé durables. Pour que l’acte de soigner cesse de nuire, et commence à guérir aussi… la planète.
Olivier TOMA
Fondateur de Primum Non Nocere®